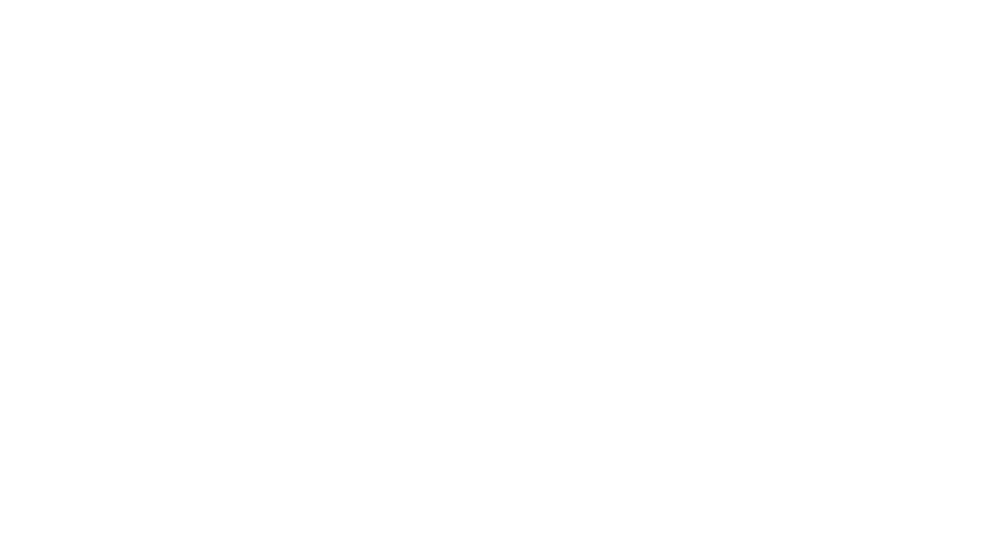Qui êtes-vous Yosra Frawes ? Avocate et militante féministe et des Droits humains, comment voyez-vous votre combat ?

Je suis d’abord une femme, c’est-à-dire un être humain qui porte sur lui le tort d’être né avec un sexe féminin, né et éduqué systématiquement à être inférieur. J’en ai pris conscience dès mon plus jeune âge en voyant, dans mon village paysan, des jeunes filles qui arrêtaient leur scolarité pour aller travailler la terre. Je voyais que ces jeunes filles n’avaient ni contrat de travail ni sécurité sociale et il n’était pas évident qu’elles puissent gérer seules, avec leur petite prime de fin de journée, à l’issue d’un travail pénible. Après 1990, j’ai aussi vu la transformation de mon village après l’installation d’une zone industrielle, avec l’ouverture de commerces, de cafés et de petits restaurants à côté des usines. J’ai vu les jeunes filles subir le même sort que leurs sœurs, travailleuses agricoles. Dès 13 ou 14 ans elles étaient envoyées comme apprenties dans ces usines, dont la production était généralement destinée à l’export. Cela résulte des lois de 1972 qui permettent une exonération fiscale importante pour des investisseurs qui trouvent une main d’œuvre massive, bon marché, avec très peu de droits sociaux. Une convention tacite, passée avec les autorités, privait ces filles de leurs droits syndicaux, sociaux et économiques.
Elles devenaient invisibles dans l’espace public et le même conseil, le même ordre, leur était donné : « Je veux que tu sois un homme dans la rue. Tu ne regardes pas autour de toi. Si quelqu’un t’appelle, tu ne lui réponds pas et ne lui donne aucune importance… ». Chacune commençait donc à développer sa stratégie pour y répondre. Bien sûr, certaines se révoltaient contre ces codes sociaux, mais la majorité s’y inscrivait largement.
Je comprends alors que si je ne termine pas mon cursus scolaire et universitaire je subirai le même sort : travailler, dès mon plus jeune âge, dans une usine, d’autant plus que j’appartiens à une famille qui était loin d’être aisée.
Il faut travailler pour la famille et pour constituer son capital matrimonial. Vers 20 ou 21 ans maximum, il faut avoir épargné pour son trousseau et avoir trouvé son prince charmant dans le village. Quelqu’un du village bien sûr, pour prouver que je n’ai pas dragué entre temps. C’était ça être une femme. On le comprend par élimination entre ce quoi on a droit et ce que l’on ne peut pas faire. Quand je l’ai compris, j’ai commencé à (me) poser plein de questions et à fréquenter le milieu féministe, grâce à une enseignante de mon lycée qui m’a invité une fois, en 1994, à participer à une activité organisée par l’ATFD. Je suis allée, avec mon tablier de lycéenne, à la Médina, en centre-ville de Tunis, écouter et participer à un débat avec des intellectuelles et des artistes sur un feuilleton très populaire à l’époque. La conférence portait sur les stéréotypes sociaux que véhiculait ce feuilleton, tant aimé par toutes et tous. À partir de là, j’ai commencé à développer un regard un peu plus critique sur ce feuilleton qui me captivait. J’ai entendu, lors de cette activité, des femmes, parler autrement, d’une manière savante, sophistiquée, sur quelque chose qui était mon vécu.
En rentrant à la maison, j’ai dit à ma mère avoir rencontré des femmes différentes de celles du village, des femmes parlant un français parfait, cultivées et osant même critiquer le président Ben Ali. Ce sont des femmes courageuses et je ne comprends pas qu’il n’y en ait pas dans le village. Ma mère m’a dit : « Ces femmes-là t’ont plu ? Eh bien passe ton bac et tu auras le droit d’en faire partie. Et moi je veux que tu sois comme elles. ». Et c’est comme cela qu’elle m’a mis en tête que mon parcours pourrait être différent de l’entourage dans lequel elle m’a élevé. C’était mon destin, mais aussi un choix réel. Après mon inscription à la faculté de droit j’ai demandé à mon enseignante de lycée l’adresse de l’ATFD. Ce fut mon premier pas dans l’engagement féministe.
Comment évoluent les droits des femmes dans la Tunisie post révolution ?
Les paradigmes ont changé depuis 2011. Avant, il y avait le féminisme de l’État, institutionnalisé, paternalisé par le grand combattant Bourguiba, puis par le Président protecteur de la nation, Ben Ali. C’était à eux seuls de décider de quels droits les femmes avaient besoin. Ils ont créé la fête nationale de le femme tunisienne le 13 août, ce qui est unique au monde. On fête le 8 mars d’une manière contestataire puis le 13 août, de façon très institutionnelle.
On a passé 60 ans à nous dire comment doivent être les femmes. De manière très hégémonique, il y avait les organisations de l’État faisant la promotion de la femme tunisienne (on n’utilise pas le pluriel) tout en faisant la propagande du système et du gouvernement en place. À partir des années 70, il y a eu des féministes qui ont commencé à se révolter contre ce modèle paternaliste et patriarcal à la fois. Elles ont commencé à positionner la question des droits des femmes dans la lutte sociale et démocratique et c’est comme cela que le mouvement féministe est né, pour protester contre un code de statut personnel, présenté comme une exception dans le monde arabo-musulman. Il y a eu des politiques publiques avant-gardistes comme le droit à l’avortement dans les années 60, l’accès égalitaire à l’éducation, le droit à l’adoption.
Ce sont des avancées qui ont été données par les deux présidents pendant la dictature des 60 ans. Quand les femmes, autonomes de ce système, ont commencé à critiquer le chemin qu’il reste à faire pour arriver à l’égalité, à dire que finalement on est en-deçà de ce que l’on mérite, que nous sommes des citoyennes à part entière et que nous avons le droit à une égalité sans discrimination aucune, elles ont commencé à être perçues comme des opposantes, comme des râleuses, comme des personnes qui ne se contentent jamais de ce qu’on leur donne, comme des traîtres aussi, parce qu’on leur donne des droits alors qu’on est en train d’opprimer les opposants politiques, d’interdire toute pluralité, tous les médias, même apolitiques. Il n’y avait donc pas de pluralité sur tout ce qui était public en fait, et quand même, elles osaient critiquer. Elles sont alors mises sur le compte de l’opposition et comme ce sont des femmes qui ont un engagement syndicaliste, un engagement dans les partis de gauche, cela arrange le pouvoir de les classer dans l’opposition, comme des femmes qui essaient d’imposer des agendas de l’étranger, de l’occident et qui ne sont pas connectées à la réalité sociale. Aussi, rapidement, elles ont été réprimées systématiquement.
Après 2011, il n’y avait plus à réprimer des organisations féministes autonomes, mais en même temps arrivaient les islamistes. On sort alors du paternalisme féministe pour tomber dans un paternalisme théologiste, conservateur, réactionnaire. Notre mission est devenue encore plus difficile parce que les femmes comptaient sur nous au regard de notre légitimité historique. Elles venaient vers nous en tant que victimes de violences, de discriminations. Elles réclamaient des droits et elles voulaient qu’on soit leur voix et qu’on porte leurs revendications sur la scène publique, parce qu’on était reconnues malgré les campagnes de lynchage à notre encontre qui avaient commencé dès les premières marches et manifestations qu’on a organisé après la chute de Ben Ali. Notre mission est devenue plus difficile parce que nous avions la responsabilité de sauvegarder et de préserver les acquis. On sait très bien que les phases de transition démocratique sont souvent des phases très fragiles et dans plusieurs expériences les premières perdantes des transitions, qu’elles soient armées ou pacifiques, sont les femmes d’abord et les libertés individuelles ensuite. Aussi, on voyait déjà le risque énorme que l’on prenait avec les islamistes.

Mais nous avions toujours des revendications d’égalité, de dignité, et comme nous avions participé pleinement à la révolution, c’était inconcevable pour nous qu’on ne reconnaisse pas notre rôle et donc qu’on ne nous donne pas nos droits, d’autant plus que la révolution tunisienne a été nommée “la révolution de la dignité”. On se pare de dignité, sans avoir des droits et dignités égaux, sans avoir une justice totale. Pour nous, la mission devenait double : préserver et promouvoir les droits, mais aussi résister aux islamistes qui essayaient de faire passer leur projet sociétal qui est un projet patriarcal justifié par la Charia. La résistance s’est organisée rapidement ; elle aussi, a dévoilé son vrai visage. On a commencé à nous faire des offres de collaboration pour inscrire la Charia dans la Constitution. Suite au premier projet sorti en 2012, on a dû sortir dans la rue, lors de manifestations nocturnes massives pour refuser la Charia qui n’a jamais été présente dans notre Tunisie. Après la Charia comme source de droit, on a essayé de nous faire passer la complémentarité à la place de l’égalité femmes-hommes. Pour eux, les femmes sont dans le rôle de la reproduction sociale et de la reproduction, et les hommes dans celui de la production.
C’est la division traditionnelle qu’ils essaient de nous imposer d’une manière très subtile avec un terme flou comme complémentarité à la place d’égalité. Nous avons dû ressortir dans la rue et organiser des séminaires pour refuser une telle subsidiarité. Ils ont cherché à faire que la Tunisie retire son adhésion à la Convention internationale pour l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (CEDAW). Mais, heureusement, ils n’étaient pas assez nombreux et notre campagne de refus d’un tel retrait et d’adhésion à d’autres instruments internationaux a permis d’avancer parce que nous avions des alliances fortes avec les partis progressistes, avec les gens des régions qu’on a découvert avec la révolution. Nous avons réuni quelques 300 femmes de toute la Tunisie pour débattre de ce qui devrait figurer dans la Constitution. De nos 12 propositions, l’Assemblée constituante en a retenu 4. Les islamistes ont essayé de faire que la Tunisie se retire de la CEDAW à laquelle elle avait adhéré en 1985. Ils ont essayé de perturber la loi sur l’adoption et de semer la zizanie dans l’opinion publique sur les droits des enfants nés hors mariage. Nous avons riposté fortement et si nous devons faire un bilan, je dirais que, depuis la révolution, il y a eu des avancées qui ont été réalisées grâce à la détermination des femmes et des féministes en Tunisie, grâce à l’acharnement des mouvements progressistes, grâce aussi au contexte, car ils ont eu peur que le scénario de Sissy, en Égypte, ne se reproduise en Tunisie.
Les islamistes ont compris qu’ils devaient céder sur la question des droits des femmes, que la société les rejetait par rapport à leur regard sur les femmes. Ces acquis ont été obtenus dans la douleur parce que, en même temps, il y a eu des assassinats politiques et des actes terroristes. Jusqu’à aujourd’hui, la clarté n’a pas été faite sur ce qui s’est passé. Des féministes ont été menacé.e.s de mort et la violence envers les femmes perdure, au moins moralement. Une machine de guerre travaille jour et nuit contre les femmes démocrates ; on assiste à une monté des forces islamistes rétrogrades et des forces qui cherchent la restauration de l’ancien régime. Quant aux forces progressistes, elles sont largement affaiblies, ce qui fait que l’ATFD a perdu des alliés au niveau des institutions.
« L’ATFD a misé sur l’école comme vecteur de changement, de développement de la personnalité, de l’esprit critique et de l’intégration dans un monde de citoyenneté et d’égalité. »
Sur quels appuis pouvez-vous compter dans votre combat pour l’égalité femmes-hommes ?
Au niveau politique, nous avons perdu des alliés, essentiellement dans les courants progressistes de gauche, mais au niveau sociétal, on peut compter sur des femmes et des hommes qui sont dans des sphères proches de nous, comme les syndicats qui, de plus en plus, nous écoutent sur la question du droit des femmes. Le 8 mars, l’UGTT a appelé à un rassemblement, avenue Bourguiba, devant le théâtre municipal de Tunis, pour que la Tunisie ratifie la convention de 1990 sur les violences dans l’espace de travail. Cet appel de l’UGTT dans la rue pour une question qui concerne les droits des femmes, est à ma connaissance une première. C’est peut-être l’un des leviers le plus important pour nous. À chaque fois que l’ATFD a subi des attaques, l’UGTT a exprimé, publiquement, sa solidarité.
Les leviers sont les défenseurs des droits humains, largement investis par des jeunes très prometteurs, la centrale syndicale et toute l’UGTT qui comprend très bien l’enjeu autour des droits des femmes qui est un enjeu pour le projet sociétal de la Tunisie.
Là où il y a moins de soutien, c’est quand il y a des questions qui partagent les Tunisiens.
En 2018, sous la présidence de Beji Caïd el Sebsi (BCS), il y avait un projet d’égalité sur l’héritage. Ce projet reprenait un peu notre recommandation et nous l’avons soutenu, mais de manière critique car il était en deçà de ce que nous attendions en tant que féministes. Il y avait autour du président tout un beau monde. Des associations, en région, nous sollicitaient pour des conférences, pour avoir un argumentaire sur l’héritage. Des partis politiques reconnus pour être assez conservateurs, ainsi que des artistes et des intellectuels, ont pris position pour soutenir l’égalité dans l’héritage.
Au moment de la campagne électorale qui a suivi le décès de BCS, la question de l’héritage a disparu, mise à part quelques candidats à la présidentielle et aucun parti n’a inscrit cette question à son programme sauf pour en combattre l’idée.
En 2020, à l’occasion du 13 août, le Président de la République – un homme élu lors de ce qu’on a appelé un référendum contre la corruption, qu’on a rapidement classé comme quelqu’un en dehors du système – a fait un long discours pour dire que la question de l’égalité dans l’héritage a été tranché dans le Coran et que le débat est imposé par une petite bourgeoisie qui milite dans les salons ; il a utilisé tous les arguments les plus conservateurs et religieux possibles. Il a affirmé qu’il représente le peuple et qu’il ne faut pas le déstabiliser en parlant d’égalité dans l’héritage. Il a fait un discours décevant pour un juriste constitutionnel et dangereux car il a puisé dans les référentiels religieux. Il a jugé le débat clos, tranché. Même le parti islamiste Ennahdha n’a jamais été aussi catégorique. Il a fait d’une journée aussi symbolique où l’on présente quelques mesures, même de facette, quelques avancées pour les femmes car c’est un réservoir électoral important, une journée où il a montré qu’il n’avait pas besoin des femmes. C’était tellement scandaleux que l’ATFD s’attendait à un flot de communiqués inondant la presse. Ce fut un silence assourdissant. Aucun parti politique, aucun responsable politique, femmes et hommes confondus, ne s’est exprimé, même sur les réseaux sociaux. Ce fut un choc pour l’ATFD. Où sont passé.e.s celles et ceux avec qui nous avions organisé la première marche pour l’égalité dans l’héritage, en 2018 ? Où est passée la coalition de 80 organisations, sur tout le territoire tunisien, avec qui nous travaillions depuis 2 années ? L’ATFD a sorti un communiqué très agressif à l’égard du Président de la République, le traitant de réactionnaire, de conservateur, d’être inscrit totalement dans la logique du réservoir électoral, parce que, finalement, il ne cherche pas les femmes pour les droits des femmes, il cherche les femmes conservatrices et leurs familles pour les rassurer sur le fait que le projet sociétal sera finalement préservé.
La seule alliance qu’on a trouvée quand on a sorti notre communiqué, fut celle des journalistes, non pas par adhésion à la cause, mais surtout parce que notre engagement été tellement fort qu’il fallait qu’il soit repris. Nous nous adressions à nos alliés pour qu’ils prennent position. Les enjeux sur certaines questions ont gagné du terrain comme la question des violences, ce qui explique l’adhésion de l’UGTT , mais pour d’autres questions nous restons les orphelines de la nation parce qu’on les pose seules ou parce que personne ne les pose avec le même engagement.
Où sont passé.e.s celles et ceux avec qui nous avions organisé la première marche pour l’égalité dans l’héritage, en 2018 ?
Quel doit être le rôle de l’école pour faire avancer la société dans un esprit d’égalité des genres ?
Je pense qu’en l’absence – et même en présence – de politique publique égalitaire, le seul vecteur qui pourrait sauver une société, lui évitant de sombrer dans l’obscurantisme, c’est bien l’école. Seulement, on a besoin d’une école ascenseur social en Tunisie, là où les filles et les garçons trouvent leur dignité dans un établissement digne de donner un peu de savoirs aux élèves. Aujourd’hui on est en manque de dignité dans les établissements scolaires, en manque de fait d’établissements. Depuis la révolution, il y a un million de filles et de garçons qui ont quitté l’école et l’école a perdu la confiance des Tunisiennes et des Tunisiens comme ascenseur social. Nous avons à mener la bataille pour reprendre l’école et lui rendre son sens, son rôle, d’abord, à éduquer sur les valeurs intrinsèques, inaliénables, comme les valeurs de l’égalité.
Depuis 2017, en tant que féministes, nous avons participé à la rédaction de la loi sur les violences à l’égard des femmes. C’est là où nous avons misé sur l’école comme vecteur de changement, de développement de la personnalité, de l’esprit critique et de l’intégration dans un monde de citoyenneté et d’égalité. L’ATFD a carrément mis dans la loi des dispositions claires qui engagent le ministère de l’éducation dans la refonte des manuels et des programmes scolaires pour y inscrire l’égalité, les droits humains et la lutte contre les violences. Nous avons ajouté une disposition pour introduire l’éducation sexuelle dans les écoles. Ça a commencé avec des expérimentations pilotes en 2018. La campagne électorale, encore une fois – parce que, malheureusement, tout dépend de la volonté politique – a été montée contre ce programme d’éducation à la sexualité pour les enfants. Certains candidats à la députation ont même fait des vidéos avec de potentiels ministre de l’éducation pour leur signifier qu’ils ne les soutiendraient que s’ils s’opposaient à un tel programme.
Depuis des années, on parle de réforme de l’éducation en Tunisie. Plusieurs tentatives ont été faites.
Au niveau de l’ATFD, nous avons fait une lecture critique des manuels scolaires pour voir, pointer du doigt les textes, les programmes, les exercices qui sont en train de véhiculer les stéréotypes sociaux et les images traditionnelles des femmes et des hommes, alors que ces images là sont probablement dépassées par la société. Il faut que les manuels scolaires suivent au moins le rythme de la société,.
Cette étude n’a servi à personne. Le ministère de l’éducation connait tout et n’a besoin de personne. Aussi, nous avons mis en place, avec l’Institut arabe des droits de l’Homme une coalition nationale pour une réforme scolaire.
Il y avait un ministre qui était un peu favorable à l’idée, il est parti, le programme est parti, la réforme est partie, toute la commission a été dissoute. C’est ce débat que nous devons engager en Tunisie, à côté du droit à l’eau, à l’environnement, avec les catastrophes écologiques, notamment dans le bassin minier. Tous ces problèmes-là doivent être la priorité de tous, État compris. Oor nous sommes dans une crise politique qui perdure maintenant depuis 3 mois. Le Président de la République ne veut pas parler au Parlement, ni au chef du gouvernement qu’il a nommé. Les institutions ne se parlent pas entre elles. Les partis politiques usent de la violence ; une députée a été giflée par un collègue dans l’enceinte du parlement. Ils sont en train de gérer leur guéguerre politicienne sur le dos des Tunisiennes et des Tunisiens qui ont été à l’origine de tout ce processus de la révolution qui les a amenés au pouvoir. Et, malheureusement ils sont incapables, incompétents et ils laissent de côté les questions stratégiques et fondamentales.
 Solidarité Laïque a une antenne Solidarité Laïque Tunisie.
Solidarité Laïque a une antenne Solidarité Laïque Tunisie.
En 2011, avec le printemps arabe, la Tunisie a engagé une période de transition profonde, à la fois démocratique et politique qui constitue un laboratoire de la transition démocratique dans le monde arabe. La société civile et les organisations qui la représentent constituent des acteurs clés de cette transition pour la défense des libertés fondamentales, le dialogue civil, la participation citoyenne et les droits économiques et sociaux. Dans ce contexte, Solidarité Laïque coordonne depuis 2012 le programme « Soyons actifs/actives » qui vise la réduction des inégalités et l’accès aux droits. Il agit dans trois domaines clefs pour cela : l’éducation, l’insertion socioprofessionnelle/l’économie sociale et solidaire et la démocratie locale et participative. Ce programme fédère désormais près de 80 organisations françaises et tunisiennes, associations, syndicats, collectivités territoriales et pouvoirs publics.
En 2018, Solidarité Laïque, ses membres et ses partenaires ont renouvelé et renforcé leur engagement, notamment en Tunisie, avec le lancement d’un programme « Jeunes des deux rives – J2R », un projet d’éducation à la citoyenneté et à la solidarité internationale initié en 2017, par l’organisation française « Migrations et Développement », qui vise à renforcer le pouvoir d’agir et les parcours d’engagement de jeunes de France, du Maroc et de Tunisie. Ce projet encourage la jeunesse à être vecteur de paix.