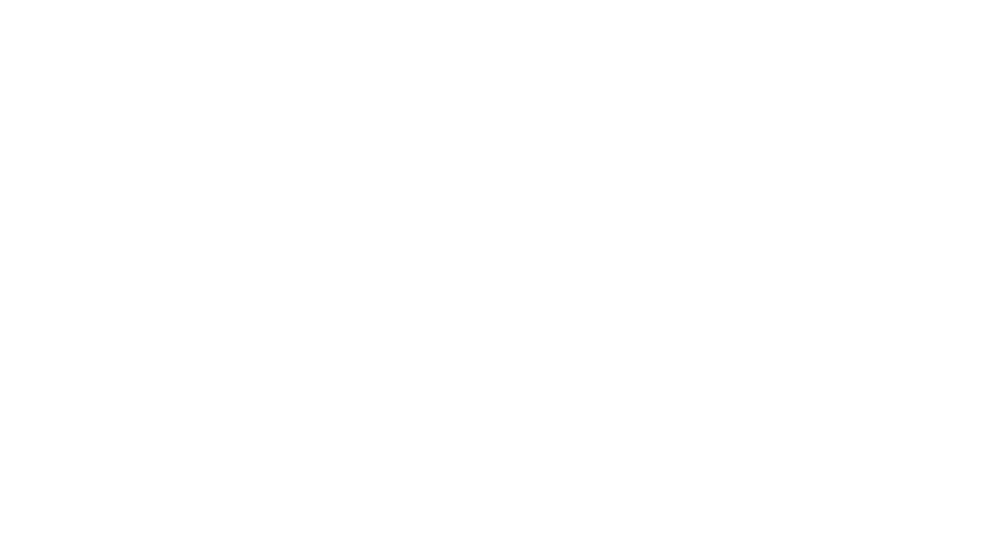La vivacité des débats que l’évocation de la laïcité suscite, la diversité des rôles que lui assignent ceux qui s’y réfèrent, imposent un travail de clarification, seul de nature à lui faire retrouver la fonction émancipatrice qui lui permit, jadis, de desserrer l’emprise confessionnelle d’une Eglise dominatrice. Au sein, aujourd’hui, d’une société que sa diversité croissante écartèle entre la tentation d’une uniformisation contrainte et celle d’une dangereuse paresse multiculturaliste, elle reste le principe central permettant d’assurer une gestion intelligente et pacifiée des complexités qui la travaillent et contribuent à sa richesse. Aussi, alors que ce principe fondateur de l’identité républicaine – tiraillée entre d’accaparements à visée idéologiques qui en travestissent le sens et en détournent la fonction émancipatrice, et nostalgies d’un âge d’or qui n’a jamais existé que dans l’esprit de ceux qui s’y réfèrent – a retrouvé une place centrale dans le débat public, importe-t-il de tenter d’en comprendre les évolutions récentes afin de définir les conditions permettant lui conférer une pleine opérativité.
Animée d’une logique d’émancipation des institutions publiques par rapport aux conditionnements cléricaux, des individus par rapport aux assignations confessionnelles, la laïcité ne peut se concevoir sans la liberté qui en soutient le développement et dont elle favorise, en retour l’affirmation. Plus largement, il ne peut y avoir de laïcité concevable en l’absence de libre débat démocratique entre convictions opposées.
C’est ce que d’ailleurs affirmaient, pratiquement à l’unisson, des artisans de l’élaboration et du vote de la loi du 9 décembre 1905. « Loi de liberté » pour Aristide Briand, loi « libérale, juste et sage » pour Jean Jaurès. Même Emile Combes dont les vues ne coïncidaient pas nécessairement avec le choix final du législateur, y voyait une « loi de liberté, d’affranchissement moral et de paix sociale ». Tout cela avait été rendu possible, par-delà l’organisation des modalités concrètes de privatisation du régime juridique des cultes, grâce à la subtile alchimie des principes posés par ses deux premiers articles. Le premier, explicitant les termes de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, réitérait l’obligation pour la République d’assurer la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes, le second, souvent le seul cité, posait le principe de la neutralité confessionnelle de l’Etat : « La République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte ». Certes, l’ordre public démocratiquement débattu imposait-il que des limites puissent être posées à la libre pratique des cultes, certaines d’entre elles sont posées par la loi elle-même, mais le juge sut en faire une lecture intelligente constamment rapportée à une analyse des circonstances particulières de temps et de lieu. Ainsi en est-il allé des débats relatifs aux sonneries de cloche ou aux processions religieuses. Pas la moindre trace d’essentialisme boursoufflé dans cette définition des limites, simplement le souci de veiller à ce que la vie commune ne soit pas perturbée par des attitudes agressives ou prosélytes.
L’apparition de nouveaux cultes et la fissuration des certitudes
Cette évidence, largement partagée, s’est imposée pendant largement plus d’un demi-siècle après l’adoption de la loi de 1905. La laïcité rimait avec la liberté dont elle était une condition par la force émancipatrice dont elle était porteuse. Des conquêtes, conduites au nom d’un souci constant de desserrer la contrainte cléricale ont été opérées, comme en 1975, la légalisation de l’interruption volontaire de grossesse ou, plus près de nous, l’ouverture du statut du mariage indépendamment de l’orientation sexuelle des futurs époux. Certes la question scolaire rôdait encore, qui manifestait la permanence de la revendication éducative des Eglises. Et puis, à partir des années 1980, quelque chose s’est brisé avec l’accaparement de la laïcité par des forces politiques jusque-là attachées à en combattre les conquêtes et corrélativement avec son basculement progressif dans une logique d’interdiction, comme si la fissuration de bloc hégémonique idéologique qui avait présidé à l’adoption de la loi de 1905, caractérisé par une situation de quasi-monopole de l’Eglise catholique, imposait de rebattre les cartes.
Le débat s’est rapidement focalisé autour de la question de la place, puis de la visibilité de l’Islam et de ses pratiques dans l’espace public. Religion pratiquée par des étrangers mais, de plus en plus, par des personnes de nationalité française qui, à mesure de leur intégration juridique, vivaient douloureusement les discriminations sociales dont elles étaient l’objet et revendiquaient une capacité d’exercice décent de leur culte. Le détonateur fut l’affaire de Creil en 1989, lorsque trois élèves musulmanes se virent interdire l’entrée dans leur collège à raison du voile qu’elles portaient. Après un avis, tout en nuances du Conseil d’Etat, attentif à faire prévaloir le principe de la liberté des convictions des élèves, le parlement votait, le 15 mars 2004, une loi d’interdiction de port de signes religieux par les élèves des établissements d’enseignement public. Entre temps, l’interdiction des signes religieux était passé de l’ostentatoire à l’ostensible, du convictionnel revendiqué au visible. Comme si ce qu’il y avait sur les têtes importait plus que ce qui se tramait dans les têtes. Puis survint l’inquiétude sur le port de voile intégral dans les lieux public, condamné au travers de la loi du 11 octobre 2010 sur l’interdiction de se voiler le visage dans les lieux public. Les prières de rue agaçaient en même temps que se profilait, après une laïcité « vestimentaire » qui a connu, au cours de l’été dernier, une poussée d’hystérie que le Conseil d’Etat a finalement endiguées, autour de la question du « burqini », la menace d’une laïcité « alimentaire » au travers des interrogations soulevées, dans la restauration collective, notamment scolaire, par la gestion d’interdits alimentaires à fondement religieux.
Question laïque et question sociale
Comme le disait Jean Jaurès, « la République française doit être laïque et sociale, mais elle ne restera laïque parce qu’elle aura su être sociale ». La remarque n’a jamais été aussi vraie. Non seulement l’existence de zones d’exclusion est incompatible avec l’idéal républicain d’égalité et de fraternité, mais surtout, elle porte en germe l’émergence de constructions identitaires de substitution, au mieux créatrices d’enfermements communautaires, au pire, génératrices de trajectoires individuelles nourris d’une soif de revanche. La IIIe République à bien des égards si peu socialiste l’avait compris dont le projet éducatif était mis au service de la construction d’un peuple de républicains. Jean Macé ne disait pas autre chose dans son discours de clôture du VIe Congrès de la Ligue de l’enseignement : « il y a un terrain sur lequel la Ligue est apte éminemment à faire œuvre de conciliation : c’est le terrain de la lutte des classes, plus grave encore, en définitive, que la lutte des opinions politiques. Dans la lutte des classes, où peut-on trouver meilleur terrain de réconciliation que le terrain de l’enseignement de ceux qui ne savent rien par ceux qui savent quelque chose ? » Le traitement de la question sociale a changé de même que celui de la question laïque. Aucune des deux n’est totalement laissée en jachère, mais désormais chacune d’entre elle donne lieu à des traitements spécifiques. La question sociale mobilise la mise en œuvre de processus volontaristes destinés, par la recherche d’une mixité sociale et au travers de mécanismes compensateurs à réparer les conséquences d’inégalités de statut. Lui manque cependant une analyse plus fine des raisons qui expliquent les stratégies de regroupement communautaire et par là même d’assignation et le constat que de plus en plus de jeunes victimes de cette assignation naisse, comme le souligne Régis Debray, « sous X en terme de valeurs »[1]. A y regarder de plus près et sans ignorer les raisons économiques du phénomène, il est vraisemblable que le refus têtu de reconnaître les différences culturelles et cultuelles et le traitement de ces dernières comme autant de symptômes d’un refus d’intégration y est pour beaucoup. D’autant qu’à l’inverse, la question laïque se trouve soumise à un traitement destiné à faire disparaître ce qui, dans le comportement visible, peut affecter l’image que nous nous ferions de notre identité collective. Redoutable basculement qui a conduit à transformer la laïcité de mode d’organisation d’une neutralisation confessionnelle des institutions en véritable idéologie, ce que n’avaient ni envisagé ses concepteurs, ni n’est conforme à la fonction émancipatrice qui est la sienne.
La transformation de la laïcité en une idéologie [1] : la dérive identitaire.
L’intensification du débat autour, principalement, de la pratique du culte musulman et de sa visibilité s’est accompagnée de la découverte des vertus de la laïcité par des forces politiques qui jusqu’alors s’en étaient tenues éloignées, attachées qu’elles étaient, pour certaines d’entre elles, à la défense de l’enseignement privé. Aux mouvements laïques traditionnels venaient se mêler des laïques du lendemain, qui voyaient dans un principe dont ils ne cessaient de contester certaines des applications l’instrument qui leur permettraient d’exorciser les peurs qu’ils ressentaient face aux évolutions traversant la société française. Ces néolaïques se divisent en deux catégories, les tenants d’une laïcité de repentir, principalement catholique, en premier lieu, les laïques identitaires ou éradicateurs en second lieu.
Les tenants d’une laïcité de repentir, qualifiés parfois de « catho-laïques », semblent gagnés par le doute quant à la pertinence des combats conduits au nom d’un principe dont ils se réclament cependant aujourd’hui. Leur laïcité conserve une mémoire catholique. Ceci les conduit à revendiquer un apaisement dans l’affirmation de l’exigence laïque. Défenseurs traditionnels de l’enseignement confessionnel, ils se sont fortement opposés, au nom de leurs convictions, à la légalisation de l’avortement, au mariage pour tous, ils restent des adversaires résolus d’une légalisation de l’euthanasie. Pour eux, l’émergence d’un ordre public laïque, articulé autour d’une neutralité confessionnelle de l’État, ne peut se concevoir indépendamment d’une référence aux racines chrétiennes de l’identité française. Ils ont reçu un concours de poids en la personne de Nicolas Sarkozy qui, dans le discours du Latran puis dans une intervention au Puy-en-Velay au mois de mars 2011, a pensé pouvoir confirmer le statut de « fille aînée de l’Église » de la France. Dans le premier de ces discours, prononcé le 21 décembre 2007 dans la salle de la Signature du palais du Latran à l’occasion de la remise du titre de chanoine d’honneur du Latran, outre la référence aux outrages qu’auraient subis l’Église catholique en 1905, Nicolas Sarkozy affirmait que, « dans la transmission des valeurs et dans l’apprentissage de la différence entre le bien et le mal, l’instituteur ne pourra jamais remplacer le curé ou le pasteur […] parce que lui manquera toujours la radicalité du sacrifice de sa vie et le charisme d’un engagement porté par l’espérance ». Cette récusation de l’aptitude de l’instituteur à dire mieux et plus sûrement ce que doivent être les canons moraux d’un comportement social, Adolphe Thiers l’avait déjà exprimée, en 1850, lors du débat sur la loi Falloux. La laïcité était sommée de devenir « positive », façon de dire qu’elle ne l’avait pas été jusque-là. Certes, la France est un pays de culture catholique, son calendrier, le choix de la plupart de ses jours fériés, en attestent. Mais l’on ne saurait confondre références culturelles et emprise confessionnelle d’une Église. La laïcité ne s’est pas construite contre la religion catholique, elle s’est limitée, mais là est l’essentiel, à poser des barrières à la puissance sociale des Églises et, notamment, à celle de l’Église catholique.
Les laïques identitaires ou éradicateurs, qu’il s’agisse du Bloc identitaire, de Riposte laïque ou de Front National, tout en feignant de s’affranchir de toute référence religieuse et au prétexte de lutter contre les communautarismes, voudraient faire du principe de laïcité dont ils se réclament, assorti de réserves voisines des laïques du repentir, l’instrument de sauvegarde d’une identité fantasmée de la France. Tout ce qui visiblement heurte leur regard est sommé de disparaître. Pour ces initiateurs des « apéros vin et saucisson » ou des « soupes au cochon », l’ennemi c’est la religion musulmane et ses pratiques vestimentaires, cultuelles ou alimentaires. La qualité de Français se juge plus aux comportements que l’on adopte qu’au partage de valeurs communes. Alors que l’essentiel des mosquées existantes ne disposent pas de minarets, ils font de leur interdiction un thème de campagne à l’instar du parti populiste suisse, l’Union démocratique du centre, qui fit approuver par référendum, au mois de novembre 2009, une proposition en ce sens. Prières de rues, voiles intégraux ou non, parfois simple apparence, façon de se vêtir, de se nourrir constituent autant de prétextes à mobilisation, autant d’atteintes à une identité nationale, volontiers xénophobe quand elle n’ouvre pas les vannes d’un racisme haineux sur les réseaux sociaux. La laïcité acquiert pour eux une fonction épurative, éradicatrice, exactement à rebours de la conception qu’en avaient les rédacteurs de la loi du 9 décembre 1905.
Sous l’influence de ces nouveaux courants, la laïcité cesse d’être un outil d’émancipation et un principe de liberté pour se transformer en instrument permettant de purger l’univers visible de ce qui blesse leur regard. L’ordre public tend à se réduire à un moyen d’assurer la sauvegarde d’une identité nationale refermée sur elle-même, exclusive de toute influence qui la viendrait pervertir, méfiante et parfois résolument hostile à toute immigration qui ne ferait pas acte de capitulation devant la pauvre mémoire d’un universel sans autre imagination que la réitération de ce qui le rend si banalement singulier. Le débat engagé en 2009 sur l’identité nationale, finalement converti en une réflexion sur la question de l’islam, en a offert la navrante illustration.
Pour ces laïques d’un nouveau genre, fraîchement convertis à l’usage d’un principe qu’ils contestaient naguère et qu’ils récusent encore lorsque le débat vient à s’engager sur des sujets qui, comme la défense de l’école publique, échappent à la sagacité de leur logiciel, la laïcité se réduit, dans le meilleur des cas, à une méthodologie de gestion d’une diversité culturelle qu’ils ne supportent que sommée de faire silence dans son expression visible et qui parfois confine à un racisme identitaire destiné à sauvegarder l’image qu’ils se font d’une France ou d’une Europe christiano-centrée, fidèle à ses racines et menacée par le pratique de cultes venus d’ailleurs.
D’instrument d’émancipation, attaché à permettre à chacun de pratiquer librement le culte de son choix, ils la transforment en outil d’interdiction destiné à réduire au silence les manifestations qui les dérangent [2]. Une logique d’interdiction n’a jamais rien produit d’autre qu’un renforcement des crispations qui appellent de nouvelles contraintes pour finalement conduire à une anéantissement progressif de la démocratie et de la République.
A laisser sans réponse de telles dérives, nous nous condamnerions à voir se défaire l’essentiel des conquêtes acquises au prix de nos combats d’hier.
Des chantiers à explorer
En face d’un basculement conceptuel aussi dangereux, des réponses doivent être articulées, constamment attentives à lier la question laïque à la question sociale, centrées autour du constat du lien existant entre le renforcement des revendications rassurantes d’appartenance, notamment religieuse, et le sentiment de discrimination ou d’abandon social. Il importe d’abord de se départir de la myopie qu’induit une référence, parfois simplement incantatoire, à un universalisme dont il convient de sauvegarder les vertus en le dépouillant de son orgueil. Conscient que le pluralisme culturel n’est fécond qu’à compter du moment où l’on accepte d’y voir une collection de ressources de sens, la seule façon de l’empêcher à se muer en communautarisme est d’en faire l’argument de l’invention d’un commun partagé, vraisemblablement évolutif, mais dans la construction duquel chacun pourra se voir reconnaître pour ce qu’il est et donne à voir.
Dans l’ordre du droit, en conservant la boussole d’une laïcité émancipatrice, il importe de réinterroger la distinction, assurément commode mais faussement claire, entre un espace public, nécessairement neutre et un espace privé saturé de convictions. La réalité est plus subtile. L’on se rend rapidement compte que la détermination des frontières manque de précision, qu’existent des zones grises au statut incertain. Est-il admissible que des domaines comme celui de la vie familiale ou la sexualité soient abandonnées au seul espace privé sans que soient fixées des limites dont le franchissement doit conduire à réprimer des comportements ou des attitudes socialement dangereux ? Ce ne sont pas nécessairement les lieux mais plutôt les statuts, les comportements et les activités qu’il convient de prendre en compte, en s’interrogeant constamment sur le point de savoir si l’expression de convictions religieuses ou de comportements confessionnels est de nature à porter, dans leur adoption ou leur exercice, atteinte à l’ordre public démocratiquement défini. L’on verra que l’état des personnes ou la garantie de la santé publique sont tout aussi importants, voire plus, que les menus des cantines scolaires ou les comportements vestimentaires. Que l’obligation d’effectuer une tâche, fût-ce au sein d’une entreprise privée peut imposer de s’affranchir de contraintes ou d’interdits religieux. Certains lieux justifient, certes, une attention, une neutralisation plus explicite, comme l’école, mais c’est parce que cette neutralité participe de la mission émancipatrice de l’éducation ou, plus largement, les services publics car il y va de la sauvegarde de l’intérêt général.
Par ailleurs, la République doit réapprendre à se rendre aimable. Par un apprentissage constant de la citoyenneté, au travers d’une élucidation des principes qui la fondent et aident à faire société commune à égalité de droits et de respect. Un enseignement laïque de la morale destiné à apprivoiser les principes d’une sociabilité apaisée, tel qu’il se met progressivement mis en œuvre doit y contribuer, en même temps qu’un enseignement du fait religieux permettra d’assurer une compréhension dépassionnée de ce qui construit les appartenances. Par une garantie des libertés, de toutes les libertés et, notamment, de celle de ne pas croire et de croire ou de changer de croyance, ayant l’assurance de pouvoir le faire à égalité de droits. Rien ne serait pire que l’acceptation d’une dérive sécuritaire nourrie par la suspicion et une peur entretenue de l’autre pour peu que la singularité de ce qu’il donne à voir le transforme en menace.
Enfin, et de façon plus concrète, il convient de faire confiance à la durée, en ayant en mémoire le siècle de combats qui sépare les promesses de la Révolution française des réalisations de la IIIe République. Voudrait-on que les musulmans manifestent une plus grande célérité que les catholiques à s’imprégner des vertus de la laïcité ? Un sens de la durée qui n’a de pertinence que reposant sur une confiance fraternelle démontrée dans la capacité d’évolution de ceux que l’on cherche à convaincre et sur l’affirmation que les droits qui leur sont attribués peuvent faire l’objet d’un exercice égal. Une confiance qui repose sur une aptitude à distinguer l’essentiel de l’accessoire et s’affranchit de la tyrannie du visible, l’essentiel sans lequel il est inconcevable de faire société commune, l’accessoire qui constitue cette part irréductible de singularité qui fait que l’on peut se sentir semblable sans cesser d’être soi-même.
Jean-Michel Ducomte, Président de la Ligue de l’enseignement
[1] Jean-Michel Ducomte, La Laïcité : du mot aux actes, les dangers de l’instrumentalisation, Empan n° 90, 2013, p 43 à 51
[2] Jean-Michel Ducomte, Entre respect des libertés publiques et garantie de l’ordre public : les évolutions de la normativité en matière de laïcité, in Laïcité-laïcités (sous la dir. De Jean Bauberot, Micheline Milot et Philippe Portier, Paris, éditions de la Maison des sciences de l’homme, 2014, p 319 à 343